Chers amis mélomanes,
Les variations Goldberg, partition culte de Jean-Sébastien Bach, dans une version en trio à cordes ce dimanche 16 janvier 2011 à 11h au Conservatoire de Lille, place du concert.
La transcription est due au grand violoniste russe Dmitry Sitkowetski, qui est aussi venu jouer La Truite pour chambre à part il y a deux ans...on s'en souvient.
Johann Sebastien Bach Les Variations Goldberg
arrangement pour trio à cordes par Dmitry Sitkovetsky
Thierry Koehl violon
Claudine Legras alto
Matthieu Lejeune violoncelle
Dois-je encore vous dire que ce concert n'est à manquer sous aucun prétexte...
Toute l'aquipe de Chambre à part vous attend donc et vous invite à rencontrer les musiciens autour d'un verre à la fin du concert.
renseignements et réservations : lesamischambreapart@orange.fr ou +33 607 626 125
le programme détaillé présenté par Paul Mayes ci dessous
venez nombreux, amenez vos amis et voisins...
Ambre Chapart
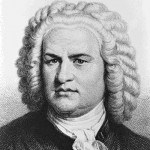
Elles inaugurent la série des œuvres monothématiques et contrapuntiques des dix dernières années de la vie de Bach. Le manuscrit autographe de la main de Bach n’a été découvert qu'en 1974 en Alsace : parmi les additifs et corrections, Bach a ajouté une série de « quatorze canons sur les huit premières notes fondamentales de l’Aria», dont le principe se retrouve dans ses œuvres plus tardives, telles que l’Offrande musicale et L’art de la fugue.
Bach a destiné les Variations Goldberg au clavecin à deux claviers, l’usage fréquent de croisements de mains rendant leur interprétation difficile sur un seul clavier.
Selon la tradition, elles furent commandées au compositeur par le Comte Keyserling. Bach était en voyage à Dresde en novembre 1741, et on peut soupçonner qu’il ait présenté au Comte Keyserling une copie des Variations Goldberg qui venaient d’être imprimées. Peut-être Johann Gottlieb Goldberg, l’apprenti claveciniste et élève extrêmement doué de Johann Sebastian et de Wilhelm Friedemann Bach a-t-il joué ces Variations à son maître le Comte pour distraire ses longues nuits d’insomnies.
Mais cette légende est néanmoins largement contestée aujourd’hui, du fait de l’absence de dédicace au frontispice de l’édition de 1741, très en coutume à l’époque, et de l’absence, dans l’inventaire des biens de Bach après sa mort, de traces des riches cadeaux faits par Keyserling à Bach (selon Forkel, une coupe en or remplie de cent louis d’or). De plus, l’âge du jeune Goldberg nous laisse penser qu’il est très peu probable que lors de la composition, qui daterait au plus tard de 1740, Bach ait songé aux talents de son élève, tout juste âgé de 13 ans. Il vaut sans doute mieux attribuer ces “exercises pour clavier” à une initiative personnelle du compositeur.
A partir de l’Aria introductive, une sarabande lente et ornée, et fondée sur le motif de basse très répandu de la “gagliarda italienna” (gaillarde italienne), Bach crée un immense univers en développement, qui regroupe de nombreux styles musicaux : Canons, fugues, gigues, chorals ornés. Ce développement se compose de trente variations, séparées en deux grandes parties de quinze variations, la seconde partie commençant par une ouverture. Après ces trente variations dans lesquelles Bach emploie tous les moyens imaginables pour partir du même point et pour revenir au même point (chaque variation correspond à une mesure de l’Aria), il clôt le cycle par une réitération de l’Aria. Le nombre de mesures et la tonalité des mouvements (Aria, 30 variations, Aria da Capo) concordent, la relation est parfaite, ce qui était très important pour Bach.
En plus de la division en 2 parties de quinze Variations, elles se regroupent également en 10 ensembles de 3 variations, fournissant pour support une gradation contrapuntique concluante : chaque troisième mouvement est un canon, les intervalles d'imitation montant successivement de l'unisson (dans la variation.3) à la neuvième (variation 27). Au lieu du canon à la 10e prévisible, la variation 30 est un quodlibet qui combine avec fantaisie plusieurs thèmes populaires en contrepoint : Ich bin so lange nicht bei dir gewest, rück her, rück her (“Il y a si longtemps que je ne suis plus auprès de toi, rapproche-toi, rapproche-toi”) ; et Kraut und Rüben haben mich vertrieben Hätt’ mein’ Mutter Fleich gekocht, so wär’ ich länger blieben (“Choux et raves m’ont fait fuir, Si ma mère avait fait cuire de la viande, je serais resté plus longtemps”). La première mélodie était très répandue au XVIIe siècle comme Kehraus (dernière danse), morceau que l’on jouait pour faire comprendre que la soirée se terminait. A l’instar de la Chaconne pour violon solo, ces variations reposent davantage sur la basse continue que sur l’air principal, selon la technique de la chaconne ou du ground anglais.
Dans la discussion autour des remaniements des œuvres de Bach, les esprits se divisent entre ceux qui y voient une nouvelle facon de voir l’original et ceux qui ne reconnaissent que l’original avec la conviction que seulement la première notation et une interprétation “authentique” peuvent rendre justice à l’œuvre. Mais, avec leur variété s’étendant depuis la parodie en passant par la transcription jusqu’à la pure fantaisie libre, les transcriptions ont souvent été utilisées pour rendre hommage à la musique des autres en projetant sur elles une lumière nouvelle. De la même manière que Bach a remanié sans crainte des œuvres de Vivaldi et d’autres contemporains, Mozart, de son côté, a transposé des fugues de Bach pour trio à cordes.
Dans sa transcription des Variations Goldberg pour trio à cordes, le violoniste Dmitry Sitkovetsky cherche à éclairer à sa facon le génie de Bach. Les rôles du violon, de l’alto et du violoncelle ne sont pas partagés ici à la manière d’un ensemble à cordes baroque avec une basse continue : les trois partenaires égaux forment les trois registres différents d’un seul instrument.
Bach a dédié cet Aria avec plusieurs variations “aux amateurs, pour la délectation de leurs âmes”, et c’est dans cet esprit que cette nouvelle version de ce chef d’œuvre absolu doit être abordée.
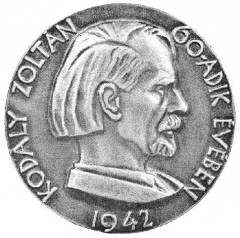 La plupart des musicologues à travers le monde qualifieraient Béla Bartók du plus important compositeur hongrois du 20e siècle, mais pour les hongrois il est dépassé comme patriarche et comme patriote par Zoltán Kodály. Tandis que les six quatuors de Bartók sont une pierre angulaire dans son œuvre, Kodály n’en produisit que deux, qui sont bien moins connus. Personne pourtant n’aurait pu être mieux préparé pour écrire des quatuors à cordes que Kodály. Il commença à jouer du violon à l’âge de dix ans et, quelques années plus tard, il apprit lui-même à jouer du violoncelle, dans le but précis de se familiariser avec le répertoire du quatuor à cordes. Il jouait aussi de l’alto dans une certaine mesure et il ne lui était pas impossible de jouer des trois instruments au cours d’un seul et unique événement.
La plupart des musicologues à travers le monde qualifieraient Béla Bartók du plus important compositeur hongrois du 20e siècle, mais pour les hongrois il est dépassé comme patriarche et comme patriote par Zoltán Kodály. Tandis que les six quatuors de Bartók sont une pierre angulaire dans son œuvre, Kodály n’en produisit que deux, qui sont bien moins connus. Personne pourtant n’aurait pu être mieux préparé pour écrire des quatuors à cordes que Kodály. Il commença à jouer du violon à l’âge de dix ans et, quelques années plus tard, il apprit lui-même à jouer du violoncelle, dans le but précis de se familiariser avec le répertoire du quatuor à cordes. Il jouait aussi de l’alto dans une certaine mesure et il ne lui était pas impossible de jouer des trois instruments au cours d’un seul et unique événement.  Szymanowski envers la jeune république polonaise se retrouve dans l’intérêt qu’il porta à la musique populaire polonaise qui donna à son style un aspect nouveau voire néo-classique.
Szymanowski envers la jeune république polonaise se retrouve dans l’intérêt qu’il porta à la musique populaire polonaise qui donna à son style un aspect nouveau voire néo-classique. Leoš Janáček ont pour thème commun l’éternel dilemme des relations sentimentales humaines, oscillant d’une part entre le désir et une idée belle mais malheureusement souvent irréelle - et d’autre part la réalité posant au sentiment naturel de nombreux obstacles sous forme de conventions sociales. Ces deux morceaux sont d’une manière toute particulière à programme et leur déclaration concrète et leur expression suggestive en découlent.
Leoš Janáček ont pour thème commun l’éternel dilemme des relations sentimentales humaines, oscillant d’une part entre le désir et une idée belle mais malheureusement souvent irréelle - et d’autre part la réalité posant au sentiment naturel de nombreux obstacles sous forme de conventions sociales. Ces deux morceaux sont d’une manière toute particulière à programme et leur déclaration concrète et leur expression suggestive en découlent. 
 Ignacy Jan Paderewski (1860-1949) a joué un rôle exceptionnel dans l’histoire de la Pologne, non seulement comme musicien, mais aussi comme homme d’état, et enfin comme philanthrope.
Ignacy Jan Paderewski (1860-1949) a joué un rôle exceptionnel dans l’histoire de la Pologne, non seulement comme musicien, mais aussi comme homme d’état, et enfin comme philanthrope. Si Frédéric Chopin (1810-1849) a confié l’essentiel de son inspiration au piano seul, celui-ci reste toujours présent dans son œuvre, associé à l’orchestre dans quelques œuvres de jeunesse, ou à la voix dans les mélodies. Dans la musique de chambre, qui n’occupe qu’une place très marginale de son œuvre, le piano se voit dangereusement concurrencé par un instrument favori : le violoncelle. En dehors du piano, ce fut le seul instrument pour lequel Chopin montra un intérêt réel et suivi. Il aimait sans doute lui confier le même type de mélodies puissantes et sombres qu’il écrivait pour la main gauche du piano. Deux amitiés, dans la vie de Chopin, ne furent pas étrangères à cette préférence. Dans sa jeunesse, il dédia deux œuvres pour violoncelle au Prince Anton Radziwill, aristocrate polonais et violoncelliste amateur. Plus tard, à Paris, il se lia avec le grand violoncelliste Auguste Franchomme, qui devint un de ses plus fidèles amis ; il composa pour lui le Grand Duo sur “Robert le Diable” et, à la fin de sa vie, la Sonate en sol mineur.
Si Frédéric Chopin (1810-1849) a confié l’essentiel de son inspiration au piano seul, celui-ci reste toujours présent dans son œuvre, associé à l’orchestre dans quelques œuvres de jeunesse, ou à la voix dans les mélodies. Dans la musique de chambre, qui n’occupe qu’une place très marginale de son œuvre, le piano se voit dangereusement concurrencé par un instrument favori : le violoncelle. En dehors du piano, ce fut le seul instrument pour lequel Chopin montra un intérêt réel et suivi. Il aimait sans doute lui confier le même type de mélodies puissantes et sombres qu’il écrivait pour la main gauche du piano. Deux amitiés, dans la vie de Chopin, ne furent pas étrangères à cette préférence. Dans sa jeunesse, il dédia deux œuvres pour violoncelle au Prince Anton Radziwill, aristocrate polonais et violoncelliste amateur. Plus tard, à Paris, il se lia avec le grand violoncelliste Auguste Franchomme, qui devint un de ses plus fidèles amis ; il composa pour lui le Grand Duo sur “Robert le Diable” et, à la fin de sa vie, la Sonate en sol mineur. 