Chers amis mélomanes,
Poursuivant la tradition et par volonté aussi, nous continuons de faire participer les jeunes talents aux concerts professionnels. Dans le cadre du Festival l'Air de Rien du Conservatoire de Lille, le dimanche 24 mars à 11h à l'Auditorium, vous pourrez assister à un concert inédit.
lisez le programme détaillé ci-dessous, venez saluer la jeunesse
Rendez-vous place du concert, entrée libre, pas de réservations pour ce spectacle.
Attention ! le concert du 28 avril aura lieu à 11h et non pas 16h, comme annoncé initialement.
Ambre Chapart
Franz Schubert Quatuor pour flûte, guitare, alto et violoncelle, D.96
Hélène Cornu flûte Samuel Jubert guitare
Paul Mayes alto Caroline Leclercq violoncelle
Bohuslav Martinu Mazurka-Nocturne pour hautbois, deux violons et violoncelle, H.325
Claire Gueyraud hautbois Pauline Dubois violon
Léa Nour violon Catherine Martin violoncelle
Ernest Moeran Fantasy Quartet pour hautbois et cordes
Perrine Pennel hautbois Ken Sugita violon
Joséphine Kirch alto Alice Mazen violoncelle
Heinrich Hofmann Sérénade pour flute, quatuor à cordes et contrebasse
Nina Pollet flûte Ken Sugita violon
Edouard Jacques violon Paul Mayes alto
Catherine Martin violoncelle Rémi Vermeulen contrebasse
 Le très charmant Quatuor à cordes avec guitare obligée (D. 96) de Franz Schubert, intitulé aussi bien “Trio pour un quatuor avec guitare”, constitue l’arrangement d’un Notturno pour flûte, violon et guitare du compositeur Wenzel Matiegka (1773-1830), dédié, dès 1807, au comte Esterhazy (qui employa plus tard Schubert comme maître de musique pour ses filles). L’arrangement de Schubert, de février 1814, fut probablement écrit à usage domestique. Seul le second trio du Menuet, en sol majeur, peut être considéré comme de sa main. En dépit d’une paternité partagée, la contribution de Schubert à cett e œuvre révèle un talent déjà considérable, au moins dans l’écriture du violoncelle.
Le très charmant Quatuor à cordes avec guitare obligée (D. 96) de Franz Schubert, intitulé aussi bien “Trio pour un quatuor avec guitare”, constitue l’arrangement d’un Notturno pour flûte, violon et guitare du compositeur Wenzel Matiegka (1773-1830), dédié, dès 1807, au comte Esterhazy (qui employa plus tard Schubert comme maître de musique pour ses filles). L’arrangement de Schubert, de février 1814, fut probablement écrit à usage domestique. Seul le second trio du Menuet, en sol majeur, peut être considéré comme de sa main. En dépit d’une paternité partagée, la contribution de Schubert à cett e œuvre révèle un talent déjà considérable, au moins dans l’écriture du violoncelle.
Né à Policka en Bohême, où son père est sonneur de cloches, Bohuslav Martinu suit des cours de violon, puis est admis dans la classe de violon, au Conservatoire de Prague, de laquelle il se fait  renvoyer au bout de deux années. Il s’inscrit alors dans la classe d’orgue d’où il est également renvoyé, alors qu’il produit ses premières compositions. En 1920 il entre comme second violon au tout nouvel orchestre philharmonique tchèque. Il y fait la rencontre du chef d’orchestre Václav Talich et du violoniste Josef Suk. En 1923 il obtient une bourse pour étudier à Paris, et il s’y installe définitivement. Albert Roussel prend la direction de ses études musicales. Au cours des années 1930, le succès est au rendez-vous, particulièrement avec son premier opéra Juliette ou la Clé des Songes, créée à Prague en 1938 sous la direction de Václav Talich.
renvoyer au bout de deux années. Il s’inscrit alors dans la classe d’orgue d’où il est également renvoyé, alors qu’il produit ses premières compositions. En 1920 il entre comme second violon au tout nouvel orchestre philharmonique tchèque. Il y fait la rencontre du chef d’orchestre Václav Talich et du violoniste Josef Suk. En 1923 il obtient une bourse pour étudier à Paris, et il s’y installe définitivement. Albert Roussel prend la direction de ses études musicales. Au cours des années 1930, le succès est au rendez-vous, particulièrement avec son premier opéra Juliette ou la Clé des Songes, créée à Prague en 1938 sous la direction de Václav Talich.
Les nazis décrètent ses œuvres dégénérées et les interdisent là où ils ont pris le pouvoir. À leur arrivée à Paris, en 1940, Martinu se réfugie en zone libre, à Aix-en-Provence, laissant ses partitions à Paris, puis il émigre aux États-Unis en mars 1941. Au début des années 1950, il pense revenir en Tchécoslovaquie, mais s’installe dans le sud de la France et en Suisse. Il laisse un imposant catalogue de plus de 380 œuvres.
“Martinu est allé son chemin tout droit, il est resté lui-même, sans se soucier des discussions esthétiques...il a écrit une musique d’une superbe élévation spirituelle, mais il avait le courage de s’exprimer dans un idiome sonore simple, direct, accessible, où la recherche du particulier savait toujours se subordonner à la grandeur de la ligne générale.” (Marcel Mihalovici)
Mazurka-Nocturne fut écrite pour la célébration du centenaire de la mort de Chopin par l’UNESCO en 1949. Ernest John Moeran appartient à cette génération de compositeurs qui firent les beaux jours de la musique anglaise au cours de la première moitié du XXe siècle. Fils d’un pasteur d’origine irlandaise, il étudia d’abord à Uppingham School et c’est par le violon qu’il découvrit la musique. Remarquablement doué, il fut très tôt membre d’un quatuor à cordes et en 1913 le jeune musicien fit son entrée au Royal College of Music. Mais la guerre vint rapidement interrompre ses études et il fut très sérieusement blessé au crâne par un éclat d’obus : sa santé et son équilibre nerveux en souffrirent jusqu’à la fin de sa vie.
Ernest John Moeran appartient à cette génération de compositeurs qui firent les beaux jours de la musique anglaise au cours de la première moitié du XXe siècle. Fils d’un pasteur d’origine irlandaise, il étudia d’abord à Uppingham School et c’est par le violon qu’il découvrit la musique. Remarquablement doué, il fut très tôt membre d’un quatuor à cordes et en 1913 le jeune musicien fit son entrée au Royal College of Music. Mais la guerre vint rapidement interrompre ses études et il fut très sérieusement blessé au crâne par un éclat d’obus : sa santé et son équilibre nerveux en souffrirent jusqu’à la fin de sa vie.
Au terme du premier conflit mondial, Moeran enseigna la musique pendant une courte période à Uppingham avant de se remettre à étudier sous la conduite de John lreland. Ce dernier, au même titre que Frederick Delius, devait exercer une influence considérable sur l’esthétique de son jeune collègue, par ailleurs très intéressé par la musique folklorique.
Bientôt Moeran commença à faire entendre ses premieres compositions, non sans succès parfois, comme l’attestent les nombreuses exécutions dont bénéficia sa Rhapsodie n°1 pour orchestre en fa majeur de1922. D’autres partitions orchestrales suivirent: la Rhapsodie n° 2, Lonely Waters et la Symphonie en sol mineur, cependant, c’est sans doute dans le domaine de la musique de chambre que le compositeur britannique à donné le meilleur de lui même.
Le Fantasy-Quartet pour hautbois et cordes fut écrit en 1946 dans le Norfolk et reflète le plaisir qu’il éprouvait dans les paysages de sa jeunesse : certains discernent même des évocations de mélodies locales dans la partition. De plus, il a été suggéré que les rythmes vers la fin du morceau évoquent les trains à vapeur qu’il adorait tant.
Heinrich Hofmann est né à Berlin et étudia au Neue Akademie der Tonkunst avec Theodor Kulak et Siegfried Dehn. Il débuta sa carrière musicale comme pianiste et professeur mais à la fin des années 1860 ses opéras et œuvres chorales commencaient à rencontrer du succès et pendant les deux  décennies suivantes il devint un des compositeurs le plus joué en Allemagne et à travers l’Europe. Cependant, malgré les éloges de certains critiques, tel Hermann Mendel, d’autres (y compris Eduard Hanslick, le grand défenseur de Brahms) le décriaient pour son “éclectisme à la mode”. Il est vrai que sa musique n’est pas d’une grande originalité mais ses œuvres montrent malgré tout une très grande maîtrise de conception et d’écriture. Sa musique de chambre est particulièrement réussie, et la Sérénade pour flûte et cordes révèle une grande sensibilité pour la mélodie et la beauté de l’harmonie.
décennies suivantes il devint un des compositeurs le plus joué en Allemagne et à travers l’Europe. Cependant, malgré les éloges de certains critiques, tel Hermann Mendel, d’autres (y compris Eduard Hanslick, le grand défenseur de Brahms) le décriaient pour son “éclectisme à la mode”. Il est vrai que sa musique n’est pas d’une grande originalité mais ses œuvres montrent malgré tout une très grande maîtrise de conception et d’écriture. Sa musique de chambre est particulièrement réussie, et la Sérénade pour flûte et cordes révèle une grande sensibilité pour la mélodie et la beauté de l’harmonie.
 Nicolo Paganini est considéré comme l’artiste romantique par excellence : exubérant, charmant, imprévisible et révolutionaire. Il hissa la technique du violon à un niveau jusqu’alors inimaginable et il reste l’inspiration suprême pour tous les violonistes depuis. Mais cette réputation, bien que justifiée, occulte tout un autre pan de sa carrière. Comme la plupart des musiciens italiens de son époque, il devait jouer et composer la musique que d’autres, auditeurs et mécènes, lui réclamaient, et la mode était au style classique, illustré surtout par les opéras de Mozart. Malgré son caractère non-conformiste, Paganini n’a jamais abandonné les formes classiques qu’il maîtrisa dans sa jeunesse. Pendant toute sa vie il montra une préférence pour les variations et pour la forme sonate et, afin de garder une aura de mystère autour de ses prouesses violonistiques, il autorisa seulement la publication de ses œuvres qui restaient dans le cadre classique. Celles qui mettaient en avant ses innovations outrageuses ont dû attendre sa mort pour être éditées.
Nicolo Paganini est considéré comme l’artiste romantique par excellence : exubérant, charmant, imprévisible et révolutionaire. Il hissa la technique du violon à un niveau jusqu’alors inimaginable et il reste l’inspiration suprême pour tous les violonistes depuis. Mais cette réputation, bien que justifiée, occulte tout un autre pan de sa carrière. Comme la plupart des musiciens italiens de son époque, il devait jouer et composer la musique que d’autres, auditeurs et mécènes, lui réclamaient, et la mode était au style classique, illustré surtout par les opéras de Mozart. Malgré son caractère non-conformiste, Paganini n’a jamais abandonné les formes classiques qu’il maîtrisa dans sa jeunesse. Pendant toute sa vie il montra une préférence pour les variations et pour la forme sonate et, afin de garder une aura de mystère autour de ses prouesses violonistiques, il autorisa seulement la publication de ses œuvres qui restaient dans le cadre classique. Celles qui mettaient en avant ses innovations outrageuses ont dû attendre sa mort pour être éditées.  Francesco Malipiero, tous nés vers 1880, appartenaient également. Ces compositeurs s’étaient donné pour mission de montrer au p ublic que l’opéra - en particulier du vérisme - n’est pas tout et qu e l’Italie s’enorgueillit d’une riche histoire musicale. Ce rejet de l’opéra trouvait sa source dans l’enseignement qu’il avait reçu de Luigi Torchi et de Giuseppe Martucci qui, à la fin du XIXe siècle, essayaient d’introduire dans la musique et la vie musicale italiennes le style romantique allemand. Ce fut d’ailleurs Martucci qui dirigea la création italienne du Tristan und Isolde de Wagner. Rien d’étonnant, donc, à ce que Respighi ait pris en 1908 le chemin de Berlin afin d’y poursuivre ses études auprès de Max Bruch.
Francesco Malipiero, tous nés vers 1880, appartenaient également. Ces compositeurs s’étaient donné pour mission de montrer au p ublic que l’opéra - en particulier du vérisme - n’est pas tout et qu e l’Italie s’enorgueillit d’une riche histoire musicale. Ce rejet de l’opéra trouvait sa source dans l’enseignement qu’il avait reçu de Luigi Torchi et de Giuseppe Martucci qui, à la fin du XIXe siècle, essayaient d’introduire dans la musique et la vie musicale italiennes le style romantique allemand. Ce fut d’ailleurs Martucci qui dirigea la création italienne du Tristan und Isolde de Wagner. Rien d’étonnant, donc, à ce que Respighi ait pris en 1908 le chemin de Berlin afin d’y poursuivre ses études auprès de Max Bruch.  l’admiration pour les avancées considérables que l’on relève entre ses compositions des années d’étudiant et la sophistication des orchestrations qu’il réalisa dans ses premiers opéras. Néanmoins, Michele Girardi dans sa biogr aphie de Puccini décrit ses œuvres de jeunesse comme “un réservoir d’inspiration” puisqu’on trouve des éléments de ces premières compositions retravaillés même dans Madama Butterfly.
l’admiration pour les avancées considérables que l’on relève entre ses compositions des années d’étudiant et la sophistication des orchestrations qu’il réalisa dans ses premiers opéras. Néanmoins, Michele Girardi dans sa biogr aphie de Puccini décrit ses œuvres de jeunesse comme “un réservoir d’inspiration” puisqu’on trouve des éléments de ces premières compositions retravaillés même dans Madama Butterfly. 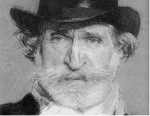 répétitions d’Aida, créée au Caire le 24 décembre 1871. Une indisposition de la cantatrice Teresa Stolz retarde les représentations, et le séjour de Verdi se prolonge jusqu’au printemps. De retour dans sa propriété de Sant’Agata, en avril 1873, Verdi confie à son ami Arrivabene : “En vérité, dans mes moments d’oisiveté à Naples, j’ai écrit un quatuor. Je l’ai fait jouer un soir chez moi sans y attacher la moindre importance et sans avoir envoyé d’invitations. Il n’y avait là que sept ou huit personnes, des habitués de la maison. Que le quatuor soit beau ou laid, je ne sais pas ... Tout ce que je sais, c’est que c’est un quatuor!” La partition sera immédiatement éditée par Ricordi, et la création publique aura lieu à Milan en 1876. Le Quatuor en mi mineur - unique exception instrumentale dans l’œuvre de Verdi - reflète les préoccupations expérimentales du musicien, nées, on le sait, d’un désir de tenir tête aux influences germaniques et d’égaler la réforme wagnérienne. En novembre 1871 une représentation de Lohengrin à Bologne, la première en Italie, l’émeut vivement. Dans ce quatuor, une “étude”, il consigne ses réflexions et dresse une sorte de bilan: à n’en point douter le Quatuor est un prolongement d’Aida, opéra longuement mûri, où se manifeste une volonté de renouveau du langage; l’harmonie, en particulier, y est plus raffinée qu’auparavant, les accords et leurs enchaînements témoignant d’une tension accrue, d’exigences sonores inédites, plus subtiles qu’auparavant, que Verdi cultivera sans cesse par la suite. Le Quatuor annonce certaines recherches poursuivies dans Otello, écrit seize ans plus tard, et témoigne de cette urgence contrapuntique qui va engendrer les fugues du Requiem et de Falstaff ; cette évolution trouvera enfin son ultime signification dans la “scala enigmatica” mise en œuvre dans l’Ave Maria des Pezzi Sacri de 1898.
répétitions d’Aida, créée au Caire le 24 décembre 1871. Une indisposition de la cantatrice Teresa Stolz retarde les représentations, et le séjour de Verdi se prolonge jusqu’au printemps. De retour dans sa propriété de Sant’Agata, en avril 1873, Verdi confie à son ami Arrivabene : “En vérité, dans mes moments d’oisiveté à Naples, j’ai écrit un quatuor. Je l’ai fait jouer un soir chez moi sans y attacher la moindre importance et sans avoir envoyé d’invitations. Il n’y avait là que sept ou huit personnes, des habitués de la maison. Que le quatuor soit beau ou laid, je ne sais pas ... Tout ce que je sais, c’est que c’est un quatuor!” La partition sera immédiatement éditée par Ricordi, et la création publique aura lieu à Milan en 1876. Le Quatuor en mi mineur - unique exception instrumentale dans l’œuvre de Verdi - reflète les préoccupations expérimentales du musicien, nées, on le sait, d’un désir de tenir tête aux influences germaniques et d’égaler la réforme wagnérienne. En novembre 1871 une représentation de Lohengrin à Bologne, la première en Italie, l’émeut vivement. Dans ce quatuor, une “étude”, il consigne ses réflexions et dresse une sorte de bilan: à n’en point douter le Quatuor est un prolongement d’Aida, opéra longuement mûri, où se manifeste une volonté de renouveau du langage; l’harmonie, en particulier, y est plus raffinée qu’auparavant, les accords et leurs enchaînements témoignant d’une tension accrue, d’exigences sonores inédites, plus subtiles qu’auparavant, que Verdi cultivera sans cesse par la suite. Le Quatuor annonce certaines recherches poursuivies dans Otello, écrit seize ans plus tard, et témoigne de cette urgence contrapuntique qui va engendrer les fugues du Requiem et de Falstaff ; cette évolution trouvera enfin son ultime signification dans la “scala enigmatica” mise en œuvre dans l’Ave Maria des Pezzi Sacri de 1898.